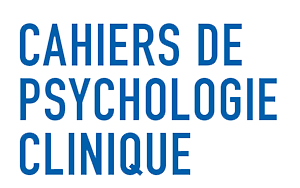La rencontre projective à l’épreuve de l’intersexuation :
Thème : Cet article propose d’amorcer une discussion sur la pertinence des fondements théoriques freudiens et post-freudiens de la méthode d’analyse des épreuves projectives développée par l’Ecole française dans le cadre d’une recherche menée auprès de personnes ayant un caryotype XY, nées entre le milieu des années 60 et les années 90, opérées et assignées en tant que filles. Contexte : Si la clinique de l’intersexuation met en crise la centralité de la binarité de la différence des sexes, socle de la théorie freudienne, cet article soutient la proposition d’un modèle théorique qui viendrait dépasser les limites qu’elle impose. Ainsi la théorie laplanchienne de l’assignation du genre, dégagée du déterminisme anatomique pour penser la genèse de l’identité sexuelle, propose une voie de sortie des impasses du modèle freudien classique pour penser cette clinique si singulière. Problématique : Dès lors qu’en est-il de la pertinence du recours aux méthodes projectives analysées en suivant les principes de la méthode française dans ce contexte ? Méthode et résultats : A partir d’éléments d’analyse que nous qualifions de classique du matériel projectif recueilli dans le cadre de cette recherche, cet article en révèle les limites et points de butée naturalistes auxquels elle amène. En s’appuyant sur l’argumentation théorique précédemment citée, il s’agira alors de soutenir l’intérêt d’une lecture laplanchienne de la situation projective en vue d’ouvrir à d’autres voies d’interprétation.
- méthodes projectives
- école française
- Jean Laplanche
- psychanalyse